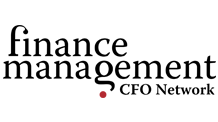Les mesures de transformation du marché de l’emploi ne constituent pas une vision du monde du travail. Cette dernière manque cruellement d’ailleurs. Pourquoi? Il semble impossible de s’entendre sur un ‘projet’ débarrassé des obstacles idéologiques qui empêchent souvent les travailleurs et les entreprises de s’aimer d’un amour sincère. Ces dernières années nous montrent que les réglementations – un coup à gauche, un coup à droite, et vice versa – ne changent rien. La politique a perdu la main. C’est l’entreprise qui a le devoir aujourd’hui de proposer une vision inspirante.
Prudence cependant : ce n’est pas un blanc-seing qui lui est donné. C’est une responsabilité. Pour les entrepreneurs, dirigeants et managers pétris d’audace, cela représente une chance exceptionnelle d’avoir la possibilité de proposer de nouveaux équilibres entre le travail, l’épanouissement, la société, la nature, le progrès,… Qui se sent prêt à émettre des propositions?
Pourquoi et comment les entreprises ont-elles conquis le pouvoir ?
Ce n’est plus tabou aujourd’hui de reconnaître que les entreprises (privées ou publiques, peu importe) ont pris le pouvoir sur la plupart des pans décisifs de nos vies quotidiennes. Momentanément en tout cas… Comment ce sortilège s’est-il produit ? Les pouvoirs publics se désinvestissent progressivement de missions essentielles à remplir, faute de trouver l’équilibre entre bonne gestion, éthique et impact concret. Ils restent empêtrés dans la résolution de dysfonctionnements internes aux dépens des attentes citoyennes. Qui prend le relais? Les employeurs.
Autre conséquence directe : les meilleurs talents n’ont plus la vocation politique ni celle de la res publica. Les cercles politiques (et syndicaux par extension) n’ont plus d’attractivité et l’incompétence des élus à tous les niveaux ne cesse de nous affliger. Dans quels cercles réfléchit-on aux tendances clés qui transforment le monde du travail (entre autres) ? A quel endroit imagine-t-on de nouvelles propositions de valeurs adressées à l’ensemble de nos collègues ? Au sein de nos entreprises ainsi que lors des échanges fructueux qu’elles entretiennent.
Les statistiques ne disent rien de la réalité quotidienne.
Une vision positive du monde du travail ne peut pas reposer sur la réalisation d’un objectif tel que celui qui consiste à atteindre un taux d’emploi de 80%.
Il y a là une confusion dans laquelle nous entrons parfois, nous aussi, entre le marché de l’emploi et le monde du travail. Le premier vise avant tout les dispositifs qui devraient veiller à l’équilibre macro-économique. Le second doit permettre d’élaborer un modèle ‘idéal’ qui se compose d’une foule d’histoires individuelles et collectives que nous pouvons embrasser, rejeter, améliorer… afin de construire celle qui nous convient.
Cette confusion est gênante lorsque les indicateurs du marché de l’emploi deviennent la finalité. Un taux d’emploi de 80%, pour ne prendre qu’un exemple, ne rend pas compte de la réalité du travail. Le chiffre n’inspire personne d’ailleurs. Pas plus d’ailleurs que les statistiques du chômage qui ne servent actuellement qu’à renforcer notre sentiment de culpabilité vis-à-vis de celles et ceux qui restent éloignés de l’insertion professionnelle.
Bien sûr, il faut des données et de la mesure. Mais il faut aussi du ressenti. Et c’est pourquoi nous avons besoin de temps immatériel que nous nous consacrons les uns aux autres pour élaborer une vision engageante du monde du travail.
Répondre au besoin de sécurité par le mouvement plutôt que par la stabilité
Marché de l’emploi et monde du travail sont donc deux réalités différentes et complémentaires. C’est la deuxième qui nous intéresse ici et maintenant. Il y a aujourd’hui trois piliers et une faille critique dans la vision d’avenir que nous voulons proposer.
En premier lieu, nous poursuivons notre marche en avant en matière d’individualisation de la relation de travail, que nous avons déjà largement évoquée. C’est le premier pilier.
Ensuite, nous avons la négociation permanente autour de la flexibilité souhaitée à la fois par les travailleurs et par les employeurs. C’est un processus d’ajustement permanent qui stimule nos capacités d’adaptation en imaginant des parcours personnels non linéaires (ce que l’on appelait jadis ‘la carrière’…) ainsi qu’une gestion du temps de travail totalement éclatée. . Deuxième pilier.
Et enfin, voici le troisième pilier, nous construisons une nouvelle version de la sécurité globale – cela va de la garantie d’employabilité au bien-être psycho-social, en passant par l’intégrité physique – qui n’est plus basée sur la stabilité mais bien au contraire sur une dynamique de mouvement, quel que soit le niveau de maturité de nos collègues.
Naviguer entre ces trois piliers est excitant. C’est aussi une sérieuse responsabilité parce qu’il y a une ‘faille’ qui nous confronte chaque jour à une brutale réalité : ce sont les inégalités croissantes (et les tensions toxiques qu’elles génèrent). Les enjeux sont considérables.
Finalement, la critique concernant l’absence de vision ou le caractère bêtement idéologique de celles qui sont développées par les gouvernements successifs n’est valable que si nous proposons ensemble une démarche volontariste. Un acte d’une folle prétention à coup sûr… et la quasi-certitude de se faire démonter par celles et ceux qui ont un avis définitif sur tout et n’importe quoi. Cela vaut la peine malgré tout ! A défaut de réussir à construire un amour sincère entre les travailleurs et leurs entreprises, ce sera un amour contrarié… C’est quand-même de l’amour.
Jean-Paul Erhard



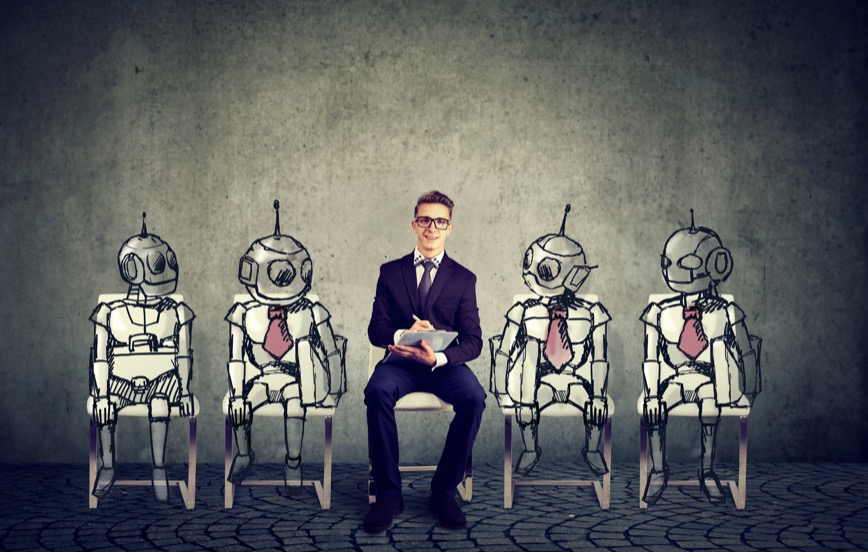
 Catégorie:
Catégorie:  Tags:
Tags: